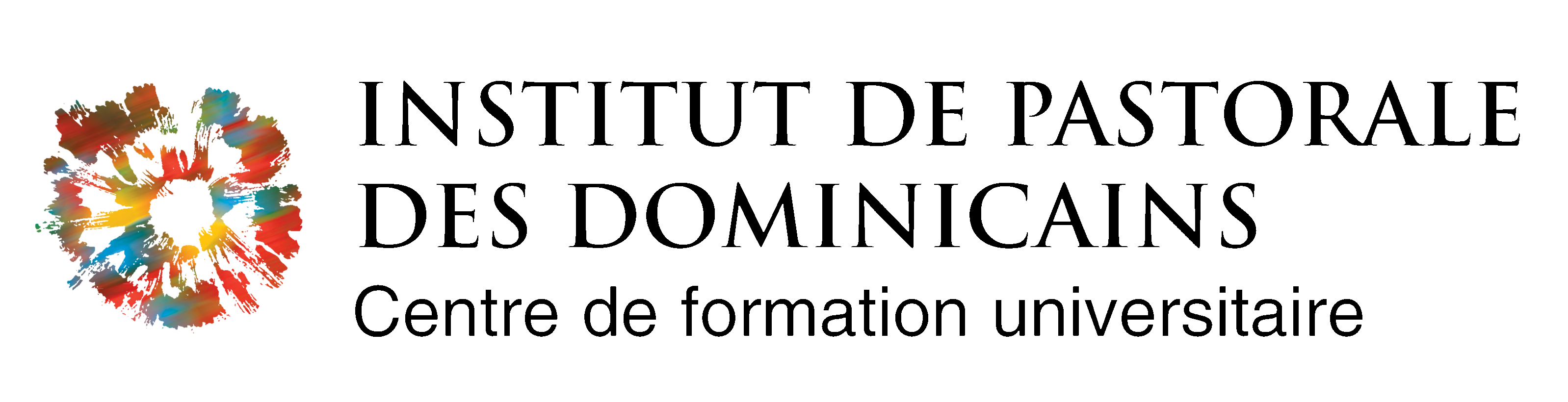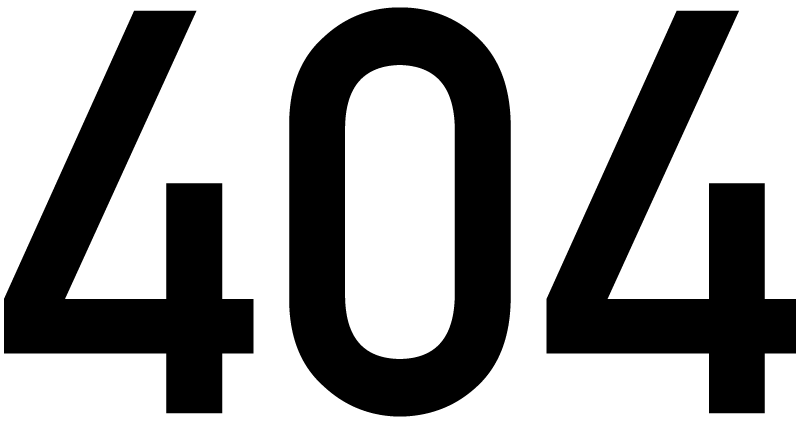Institut de pastorale des Dominicains
2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6
Téléphone: (514) 739-3223 x323
Courriel: secretariat@ipastorale.ca
Créé par Communications et Société propulsé par SedNove